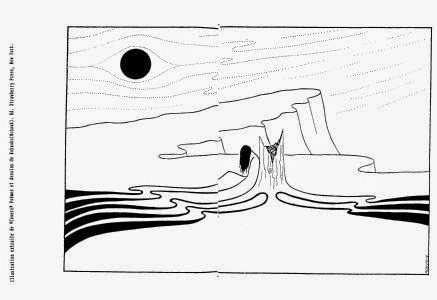Le livre qu'Hartmut Rosa nous devait après l'indigeste pavé qu'il nous avait infligé il y a deux ans (Accélération. Une critique sociale du temps, traduit par Didier Renault, également à La Découverte, 2010), pavé avec ses encombrants tableaux, gage de sérieux, ses demi-affirmations vite reprises aux trois quarts, gage de pondération, son indispensable galerie des ancêtres éclairée à la bougie, le tout lesté d'une interminable bibliographie ; une thèse, en un mot !
Rien de tout cela cette fois ; l'ambition est belle et inchangée (réintroduire la notion d'aliénation dans la théorie crtitique), l'exposé limpide, le livre bref. On y croise les fantômes - laissés dans la pénombre par une bibliographie qui fait la part belle à Habermas et Honneth ; à Charles Taylor aussi - de Marcuse, à propos du principe de rendement comme instanciation dominante du principe de réalité dans la société capitaliste et source potentielle de la rétro-action positive entre les trois formes d'accélération, technique, sociale et du rythme de vie (Rosa pointe plutôt la notion de compétition comme source de cette rétro-action mais la différence me paraît mince), ou de Benjamin et Anders, à propos des spéculations sur le temps "consumé par les deux bouts", par une mémoire qui ne se souvient de rien d'une part et par une accélération du rythme de vie qui va jusqu'à "liquider" l'avenir (au sens de Zygmunt Baumann ou de Marc Augé) d'autre part.
Extrait du chapitre 9, L'accélération comme nouvelle forme de totalitarisme
L'hypothèse que je voudrais défendre ici est que, en réalité, l'accélération sociale est devenue une force totalitaire interne à la société moderne et de la société moderne elle-même, et qu'elle doit donc être critiquée comme toutes les formes de domination totalitaire. Bien sûr, je n'utilise pas ici le mot "totalitaire" comme je le ferais pour me référer à un dictateur politique ou à un groupe, une classe ou un parti politique ; dans la société moderne tardive, le pouvoir totalitaire consiste plutôt en un principe abstrait qui assujettit néanmoins tous ceux qui vivent sous sa domination. Je suggère que nous puissions considérer comme totalitaire un pouvoir lorsque a) il exerce une pression sur les volontés et les actions de ses sujets ; b) on ne peut pas lui échapper, c'est-à-dire qu'il affecte tous les sujets ;c) il est omniprésent, c'est-à-dire que son influence ne se limite pas à l'un ou l'autre des domaines de la vie sociale, mais qu'elle s'étend à tous ses aspects ; et d) il est difficile ou presque impossible de le critiquer et de le combattre.
(...) Même les dictatures politiques brutales ne remplissent presque jamais complètement les conditions b, c et d. Il est toujours possible d'une manière ou d'une autre de résister, de se battre ou au moins de s'évader et d'échapper même aux services secrets des tyrans. Au moins ne peuvent-ils pas réguler le moindre aspect de la vie quotidienne.
Avec l'accélération sociale, c'est différent : il n'y a presque aucune arène de la vie sociale qui ne soit affectée ou transformée par les diktats de la vitesse. Puisque la progression de l'accélération sociale transforme notre régime spatio-temporel, on peut très bien le {la ? ndlc} considérer comme omniprésent{e?} et invasif{ive?}. Il {Elle ?} exerce sa pression en induisant la peur constante que nous pouvons perdre le combat, que nous pouvons cesser d'être capable de suivre le rythme, c'est-à-dire de satisfaire tous les besoins (en augmentation constante) auxquels nous faisons face, que nous pouvons avoir besoin de repos et être exclus de la course folle. Ou, inversement, en ce qui concerne le chômeur ou le malade, la peur est celle de risquer de ne jamais être capable de rattraper ceux qui sont déjà dans la course ; d'être déjà laissé pour compte. Si ceux qui sont bien équipés et qui commencent la compétition à des positions privilégiées doivent courir aussi vite qu'ils le peuvent et investir toute leur énergie pour rester dans le jeu, il est rationnel, pour ceux qui partent avec un désavantage, de ne même pas essayer de le combler : ce sont les nouveaux groupes sociaux des exclus en phase terminale, de ce que l'on appelle le "précariat".
Cependant, le point central de mon approche critique est le fait que ces diktats ne sont guère reconnus et perçus comme étant construits socialement : ils ne sont pas formulés comme des affirmations ou règles normatives - qui, en principe, a) peuvent toujours être discutées et auxquelles b) on peut résister et qu'on peut transgresser - et ils ne font pas partie du débat politique. Le temps est encore vécu comme une donnée naturelle, brute, et les gens tendent à se blâmer eux-mêmes de mal gérer leur temps lorsqu'ils ont l'impression qu'il leur en manque.Le temps, jusqu'à maintenant, est essentiellement au-delà du domaine de la politique.
(traduit par Thomas Chaumont à La Découverte, 2012)